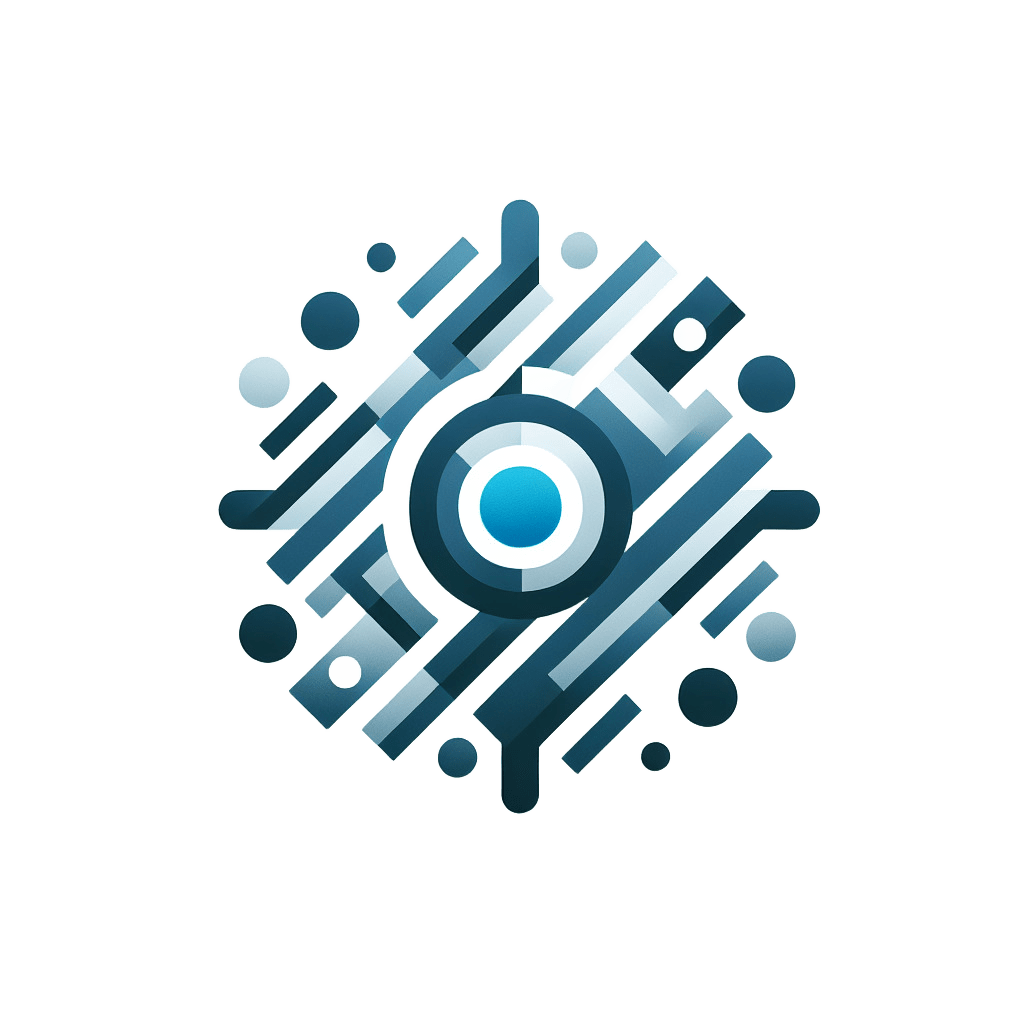Les récentes frappes israéliennes au Qatar ont suscité une vive réaction des États-Unis, qui estiment que ces actions ne servent ni les intérêts israéliens ni ceux de l’Amérique. Cette position américaine souligne un désaccord majeur sur la stratégie à adopter dans la région, alors que le conflit israélo-palestinien continue de diviser la communauté internationale et d’affecter les relations diplomatiques.
Ce qu’il faut retenir
- Les États-Unis désapprouvent les frappes israéliennes au Qatar, jugeant qu’elles nuisent aux intérêts des deux pays.
- Le soutien occidental à Israël est mal perçu par le Sud global, qui dénonce un « deux poids deux mesures ».
- Israël fait face à un isolement croissant, marqué par des interdictions de voyage et des restrictions de passeport.
- La médiation dans le conflit est compliquée par les résistances des parties et le rôle controversé des États-Unis.
- Les actions israéliennes ont des conséquences territoriales graves, notamment la destruction des terres agricoles à Gaza, posant une menace existentielle pour ses habitants.
Les États-Unis S’opposent aux Frappes Israéliennes
Washington Désapprouve l’Attaque au Qatar
Les États-Unis ont clairement exprimé leur désaccord avec les actions militaires israéliennes au Qatar. Cette position américaine souligne une divergence d’intérêts et de perceptions sur la manière de gérer la situation régionale. Washington estime que ces frappes ne servent pas les objectifs stratégiques américains dans la région. L’administration a, par le passé, cherché à maintenir une certaine stabilité et à éviter une escalade qui pourrait impliquer d’autres acteurs régionaux. L’envoi de porte-avions américains dans la région, comme le USS Gerald R. Ford et le USS Dwight D. Eisenhower, visait initialement à dissuader une extension du conflit, mais la poursuite d’opérations israéliennes jugées contre-productives complique cette stratégie. Les États-Unis ont même opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU demandant un cessez-le-feu permanent, ce qui montre la complexité de leur position, oscillant entre soutien à Israël et préoccupations quant à l’escalade.
L’Attaque Nuit aux Intérêts Américains
Les actions israéliennes au Qatar créent des ondes de choc qui affectent directement les intérêts américains. La perception internationale du soutien américain à Israël, surtout face aux pertes civiles et à la destruction des infrastructures, suscite une forte hostilité dans de nombreux pays du Sud global. Ces nations voient dans le soutien occidental une forme d’hypocrisie et un traitement différencié des situations, ce qui nuit à l’image des États-Unis. Le Brésil, par exemple, a ouvertement critiqué la gestion du conflit par les puissances occidentales. De plus, l’instabilité régionale accrue par ces frappes peut menacer les voies maritimes et les relations diplomatiques que les États-Unis s’efforcent de maintenir. L’opinion publique arabe, déjà méfiante, devient encore plus hostile, compliquant les efforts diplomatiques américains.
L’Attaque Nuit aux Intérêts Israéliens
Au-delà des implications pour les États-Unis, ces frappes israéliennes soulèvent des questions quant à leur bénéfice réel pour Israël même. L’isolement international croissant d’Israël, marqué par des interdictions de voyage comme celle des Maldives et la restauration de restrictions de passeport par le Bangladesh, témoigne d’une perception négative mondiale. Les critiques internationales, notamment celles venant du Sud global, dénoncent un possible « deux poids deux mesures » dans l’application du droit international. L’historien Vincent Lemire suggère même que la stratégie actuelle pourrait représenter une menace existentielle à long terme pour l’État d’Israël, tout en posant un danger immédiat pour les Gazaouis. La destruction des terres agricoles à Gaza, par exemple, pourrait avoir des conséquences durables sur la région et sur la perception d’Israël par ses voisins.
Critiques Internationales et Soutien Occidental à Israël
Perception Négative du Soutien Occidental
Le soutien constant des États-Unis et de nombreux pays occidentaux à Israël, alors que les bombardements et le blocus de Gaza entraînent des milliers de victimes civiles, suscite une forte désapprobation dans une grande partie de l’Amérique latine, de l’Afrique et du Moyen-Orient. On parle même d’un fossé géopolitique autour de ce conflit. Ces nations, souvent critiques envers la manière dont les pays européens et les États-Unis gèrent le dossier israélo-palestinien, ont majoritairement appuyé la demande d’un cessez-le-feu immédiat. Elles trouvent le discours occidental sur le droit et les crimes de guerre « hypocrite », pointant un « deux poids, deux mesures » en faveur d’Israël. Le Brésil, par exemple, a publiquement condamné la gestion du conflit par les puissances occidentales.
Critiques du Sud Global
Des pays du Moyen-Orient comme le Liban, la Jordanie et l’Égypte dénoncent les positions politiques et la couverture médiatique de la guerre aux États-Unis et en Europe. Ils y voient une tentative de « déshumaniser les Palestiniens ». Suite à l’explosion à l’hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza, le 17 octobre 2023, et alors que le président américain Joe Biden s’apprêtait à se rendre en Israël, des manifestations ont éclaté du Maroc à Bahreïn, en passant par la Jordanie, l’Iran et le Liban.
Dénonciation des Positions Occidentales
Un début d’isolement d’Israël se fait sentir. En avril 2025, les Maldives ont interdit l’entrée sur leur territoire aux touristes israéliens, en signe de solidarité avec les Palestiniens et en opposition aux actes commis à Gaza. De même, le Bangladesh a rétabli l’interdiction pour les détenteurs de ses passeports de se rendre en Israël.
La Chine et la Russie exploitent sans difficulté le conflit entre le Hamas et Israël comme un levier contre l’Occident. Le nombre de pays reconnaissant l’État de Palestine, 139 sur 193 membres de l’ONU, souligne une opposition forte entre le Sud et l’Occident. À l’inverse, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, le Japon et la plupart des pays d’Europe occidentale, alliés des États-Unis, ne reconnaissent pas cet État.
Ce refus est perçu comme un soutien au colonialisme, d’autant que les Israéliens s’installant en Cisjordanie sont appelés « colons ». Si les alliés occidentaux d’Israël ne parviennent pas à le convaincre de cesser sa politique d’expansion dans les territoires palestiniens, le conflit pourrait finir par opposer le Sud global à l’Occident.
L’Isolement Croissant d’Israël
Ces derniers temps, on observe une tendance claire à l’isolement d’Israël sur la scène internationale. Les actions menées, notamment dans la bande de Gaza, suscitent une désapprobation grandissante. Par exemple, les Maldives ont décidé en avril 2025 d’interdire l’entrée sur leur territoire aux touristes israéliens, un geste fort en solidarité avec les Palestiniens. De même, le Bangladesh a rétabli une interdiction pour ses citoyens de se rendre en Israël. Ces mesures, bien que ponctuelles, montrent une certaine défiance envers les politiques israéliennes.
Le soutien occidental, particulièrement celui des États-Unis, à Israël est de plus en plus critiqué par les pays du Sud global. Ces nations estiment qu’il y a un double standard dans la manière dont le conflit israélo-palestinien est traité, pointant du doigt une déshumanisation des Palestiniens dans la couverture médiatique occidentale. Des manifestations ont d’ailleurs éclaté dans plusieurs pays du Moyen-Orient suite à des événements marquants, témoignant d’une opinion publique arabe de plus en plus hostile aux positions américaines et européennes sur ce dossier. Cette situation crée un clivage géopolitique notable autour du conflit.
Les Défis de la Médiation dans le Conflit
Trouver un terrain d’entente dans ce conflit s’avère une tâche ardue. Les parties prenantes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, montrent une forte réticence à accepter un médiateur commun. C’est pourtant une étape nécessaire pour sortir de cette impasse qui dure depuis trop longtemps.
Israël, de son côté, ne voit pas d’un bon œil l’intervention des forces de l’ONU, qu’il juge peu efficaces pour garantir sa sécurité et qui compliquent ses opérations militaires. Les États-Unis sont considérés comme le garant de la sécurité israélienne. Cependant, le soutien américain, jugé inconditionnel par beaucoup, commence à poser problème. Il rend Washington moins acceptable comme médiateur pour les Palestiniens et le monde arabo-musulman. On note une légère inflexion dans cette position, avec l’évocation par Antony Blinken de possibles sanctions contre les colons israéliens auteurs d’attaques en Cisjordanie.
Les Conséquences Territoriales des Actions Israéliennes
Les actions militaires israéliennes ont des répercussions directes sur le paysage et la vie des Palestiniens à Gaza. On parle d’une réduction significative des terres agricoles, estimée à 60%, si un projet de présence militaire permanente se concrétise. C’est une menace sérieuse pour l’autosuffisance alimentaire de la région.
La situation humanitaire est déjà critique. Le blocus imposé depuis 2007 a mis à mal l’économie locale. En 2023, 81% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, et 63% dépendait de l’aide internationale pour se nourrir. Ces chiffres, issus de l’UNRWA, montrent une dépendance accrue à l’aide extérieure.
Il y a aussi des discussions sur des déplacements de population. Des documents suggèrent le transfert forcé des habitants de Gaza vers le Sinaï égyptien. Le droit international, rappelé par le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, interdit de tels transferts. La destruction des habitations, avec 70% des logements touchés, rend le retour impossible pour beaucoup. Certains observateurs estiment que la stratégie israélienne vise à créer des zones tampons ou à permettre une future colonisation, une idée déjà évoquée par des responsables politiques israéliens. L’historien Vincent Lemire souligne que si la menace est immédiate pour les Gazaouis, elle pourrait aussi représenter un danger existentiel à plus long terme pour l’État d’Israël lui-même. Les politiques tarifaires américaines, par exemple, ont montré comment des mesures économiques peuvent avoir des répercussions internationales, un point que l’OMC suit de près politiques tarifaires de Trump.
La Palestine, Clé des Relations avec le Monde Arabe
Priorité des Relations Internationales
Pour beaucoup dans le monde musulman, régler la question palestinienne représente une priorité majeure dans les relations internationales. On dit souvent que la Palestine est au cœur des problèmes dans le monde arabo-musulman. Si ce dossier trouve une solution satisfaisante pour les Palestiniens, et que l’occupation israélienne prend fin avec une aide extérieure, alors les relations entre les États-Unis et le monde arabo-musulman s’amélioreront rapidement. La résolution du conflit israélo-arabe, avec la reconnaissance d’un État palestinien et le retrait des territoires occupés depuis 1967, est vue comme la condition sine qua non pour une normalisation des relations et une paix durable dans la région. Les pays arabes se disent prêts à faire la paix et à reconnaître Israël, mais attendent la même volonté de la part d’Israël.
L’Opinion Publique Arabe Hostile aux États-Unis
La Palestine reste le dossier le plus sensible. L’opinion publique, pas seulement dans le monde arabe mais bien au-delà, reste très critique envers les États-Unis à cause de leur soutien constant à Israël. Tant que le conflit israélo-palestinien perdure, il est difficile pour l’Amérique de gagner une opinion favorable dans le monde arabe. Ce soutien américain est souvent perçu comme un biais systématique qui désavantage la cause palestinienne et arabe. Les veto américains au Conseil de sécurité de l’ONU, souvent utilisés pour protéger les intérêts israéliens, renforcent cette perception d’un manque d’équité dans le traitement des affaires internationales.
Le Blocage Psychologique Américain
Il semble y avoir un blocage psychologique aux États-Unis concernant la résolution du conflit. Malgré les nombreuses propositions de paix et les initiatives comme celle de Genève ou la feuille de route, le processus reste bloqué. Les conditions de vie dans les territoires palestiniens se sont gravement détériorées, avec un chômage élevé et une dépendance accrue à l’aide alimentaire. Les progrès réalisés après les accords d’Oslo semblent avoir été annulés, ramenant la situation près de dix ans en arrière, alors que la population a augmenté. L’absence d’une succession claire à la tête de l’Autorité palestinienne ajoute une couche d’incertitude quant à l’avenir. De plus, l’expansion continue des colonies juives et les mesures de sécurité israéliennes compliquent encore davantage la recherche d’une solution.
L’Évolution des Menaces et des Alliances au Moyen-Orient
Nouvelles Menaces Liées à l’Instabilité Régionale
La région du Moyen-Orient traverse une période de transition marquée par des changements potentiels de leadership dans plusieurs pays dans les cinq à dix prochaines années. Cette instabilité accrue crée des risques considérables, tant au niveau intérieur qu’à l’échelle régionale. L’Iran, par exemple, continue de représenter une menace constante, indépendamment des factions politiques internes, notamment dans sa quête d’armes de destruction massive. Israël et l’Arabie Saoudite partagent une préoccupation commune face à l’influence iranienne, voyant dans le rétablissement de régimes autoritaires un moindre mal comparé à l’incertitude. L’escalade du djihadisme, en partie une réaction aux politiques saoudiennes, complique davantage le paysage sécuritaire. Les conflits nationaux s’entremêlent de plus en plus avec les luttes régionales, comme le montre l’internationalisation de la crise syrienne. Cette dynamique affecte directement les pays voisins, provoquant des affrontements et une radicalisation accrue.
Réactions des Alliés Américains
Les alliés traditionnels des États-Unis dans la région ajustent leurs stratégies face à ces nouvelles réalités. La Turquie, ayant appris de ses expériences passées, se rapproche de nouveau de ses partenaires occidentaux, cherchant à sécuriser ses frontières contre l’infiltration d’extrémistes et le transfert d’armes sophistiquées. L’Arabie Saoudite, quant à elle, privilégie une approche d’endiguement face aux menaces émanant de l’Irak et de la Syrie, cherchant à contrer l’influence iranienne tout en soutenant la stabilité en Égypte. Ces pays estiment qu’un ordre établi, même autoritaire, est préférable à une situation chaotique. La fragmentation du pouvoir et la montée de l’anarchie dans certaines zones créent des environnements propices à la prolifération de groupes djihadistes, exacerbant les tensions sectaires et menaçant la sécurité régionale.
L’Iran, un Atout Stratégique
L’Iran est perçu par plusieurs acteurs régionaux, notamment Israël et l’Arabie Saoudite, comme la principale menace. Le pays est accusé de mener une guerre par procuration via des groupes comme le Hezbollah, le Jihad islamique et le Hamas, bénéficiant du soutien syrien. La présence de troupes iraniennes dans la vallée de la Bekaa, au Liban, témoigne de cette influence. Ce que certains appellent le « système du nord », reliant Téhéran, Damas, le Hezbollah et des factions palestiniennes, permettrait à la Syrie et au Hezbollah d’échapper aux pressions internationales. Il est donc suggéré que la communauté internationale adopte une position plus ferme à l’égard de Damas pour démanteler ce réseau. L’Iran, en s’appuyant sur ces alliances, cherche à projeter sa puissance et à déstabiliser ses rivaux, faisant de sa politique étrangère un élément central des nouvelles menaces au Moyen-Orient.
Un avenir incertain pour la région
En fin de compte, cette situation complique les choses pour tout le monde, y compris pour les États-Unis. L’opinion publique dans le monde arabe, et même au-delà, voit d’un très mauvais œil le soutien américain à Israël. Ce n’est pas une bonne image pour Washington. Les pays comme le Qatar et l’Égypte essaient de jouer un rôle, mais leur influence sur Israël reste limitée. L’Égypte, elle, a une longue histoire dans la région et pourrait être impliquée. Mais soyons honnêtes, avec la violence actuelle et les positions qui se durcissent des deux côtés, il est difficile d’être optimiste à court terme. On dirait que personne ne sait vraiment comment sortir de ce cycle sans fin.

Camille Lefebvre est une journaliste française passionnée de nouvelles technologies et d’innovations. Après des études en communication, elle a commencé sa carrière en tant que rédactrice en chef adjointe pour un magazine en ligne dédié aux start-ups. Depuis, elle partage son expertise et sa vision de l’actualité tech pour JournalisTech.com.